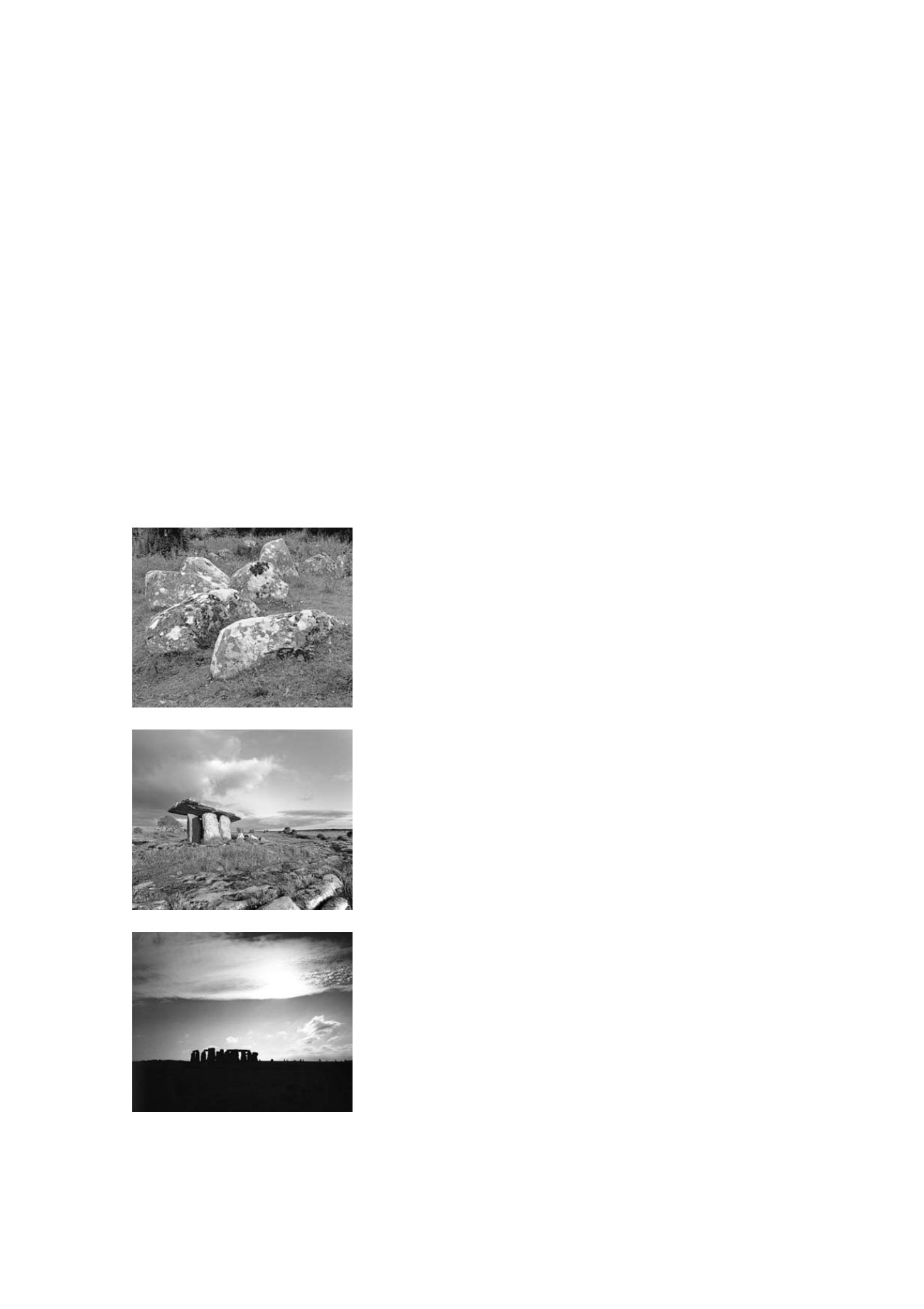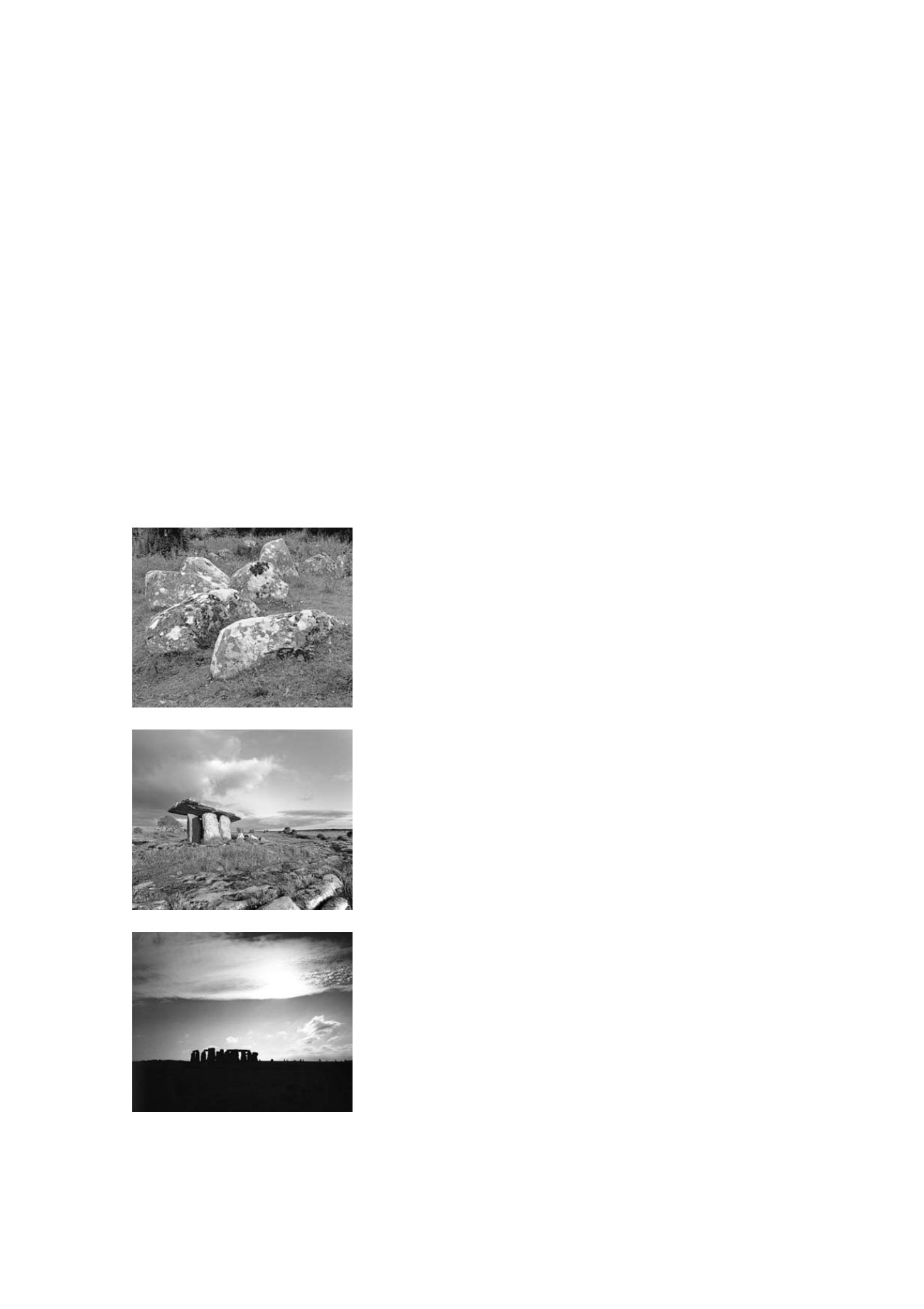
8
15
- Cromlech de Carrowmore,
FM 004
16
- Dolmen de Poulnabrone I,
FM 005
17
-Stonehenge IV,
FM 021
Abandonnées à elles -même, la matière et l´énergie se modifient et selon
le principe d´entropie passent toujours de l´ordre au désordre. Pour con-
server l´état ordonné ou pour amener un état à un ordre de plus haut
niveau, il faut donc investir du travail. Essayons de faire une analogie
entre l´entropie sociale et l´esthétique, et il existe bien une thèse que
seul l´état d´un système visuel qui correspond le mieux aux lois de
l´esthétique, est aussi le plus ordonné de tous les états visuels possibles.
Il faut donc constamment investir du travail pour conserver cet état. On
peut en conclure que sans apport de travail, l´entropie, mise ici sur le
même plan que « le désordre » du système esthétique, augmente con-
stamment. La flèche du temps dans le monde tend bien vers une entro-
pie maximum. Cependant, la réflexion sur l´entropie faite jusqu´à
présent n´aborde pas, par exemple, les processus de l´auto organisation,
mais en revanche ceux qui font appel à un apport d´énergie externe.
Dans la définition que je fais de l´entropie à orientation sociale, je pars
de cette observation que les particules ( ici les êtres humains) se trouvent
dans un état d´auto organisation croissant. On le voit très clairement
dans la formation de sociétés, dans la mise en place de systèmes juridi-
ques, dans le système scolaire et l´assurance vieillesse. Un apport de tra-
vail pour la conservation d´un certain état esthétique, seuls ceux qui en
profiteront d´une manière ou d´une autre, seront prêts à le faire. Ce sont
aujourd´hui les publicistes et les designer; ceux-ci nous font souvent don
d´une richesse de formes qui pour le moins dans certains domaines limi-
tes ne se distingue plus de l´art.
9
Si ces gens n´existaient pas, le monde
des formes et des couleurs qui nous entoure serait sans doute «piquée»de
la même façon que le monde du silence qui pour nous est en train de dis-
paraître.
Il semble qu´au cours de notre évolution, nous ayons appris à associer
notre perception sensorielle à un résultat qualifié de «bon» ou «mauvais »
ou encore «mieux» ou «pire». Cette constatation concerne dans le fond
tous les sens humains, et aussi le sens du beau. Celui-ci joue un grand
rôle, dans la maîtrise de la vie de chacun, du choix d´un époux à l´évalua-
tion visuelle de la stabilité d´objets. « Beau» est donc dans de nombreux
cas synonyme de «bon». La recherche actuelle sur le cerveau s´est aussi
penchée sur ce thème et bientôt nous en saurons plus sur les rapports
entre les notions de l´utile et du beau.
10
1 Henri Cartier- Bresson : «Meine Welt » . Lucerne et Francfort/MC.J.
bucher Verlag 1968
2 Brassai : « Graffiti ». Deux entretiens avec Picasso. Berlin, Zürich : Chr.
Belser Verlag Stuttgart 1960. Voir également Nadja Labuda : Win Labu-
das Mauerbilder, 2001( www. Classoon.de/ 12.11.10 Win Labuda
_Mauerbilder.pdf)
3 Paul Capogrino : « Megaliths », Boston : Little Brown and Company
1986( A New York Graphic Society Book)
4 Pia Müller-Tamm ( direction) : « Hiroshi Sugimoto ».Catalogue Düs-
seldorf Kunstsammlung Nordrhein- Westfalen entre autres,
Ostfildern : Hatje-Cantz 2007
5 Ernst Haas : « die Schöpfung » ( la création) Düsseldorf : Econ 1971
6 Eduardo Chillida « obra gráfica » Galerie Boisserée ( dates à préciser)
7 Levinson Jerrold « the irreducible Historicality of the concept of art «
British Journal of Aesthetics, vol.42 No4, Octobre 2002( page á préci-
ser). Ryan Dreveskracht, « A critique of Levinson » Aporia vol. 16no 1,